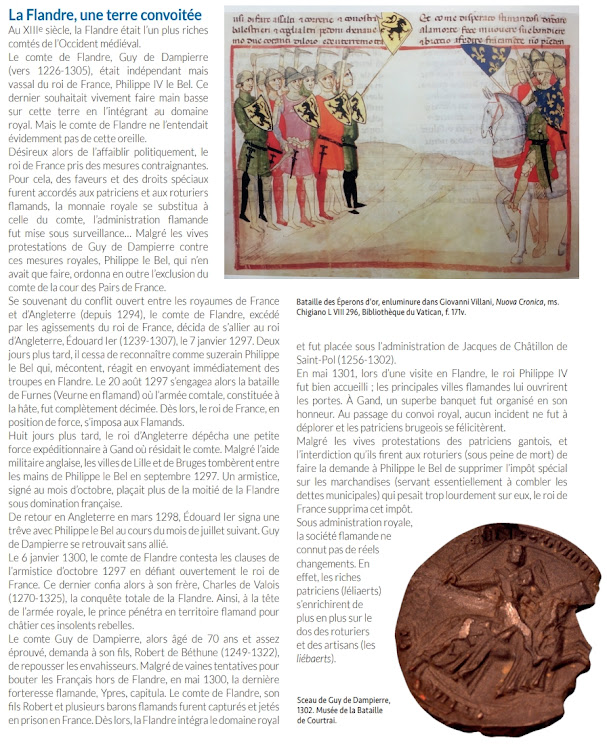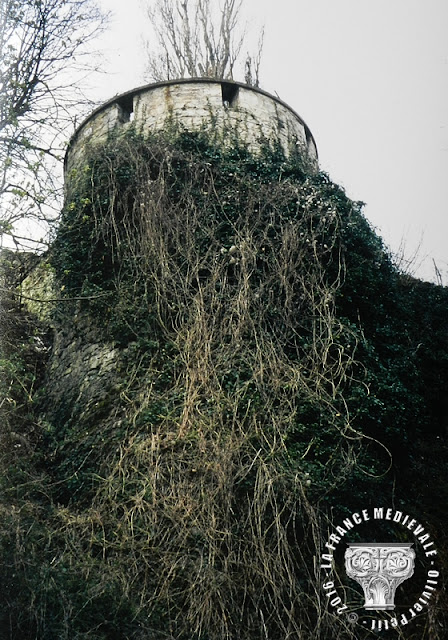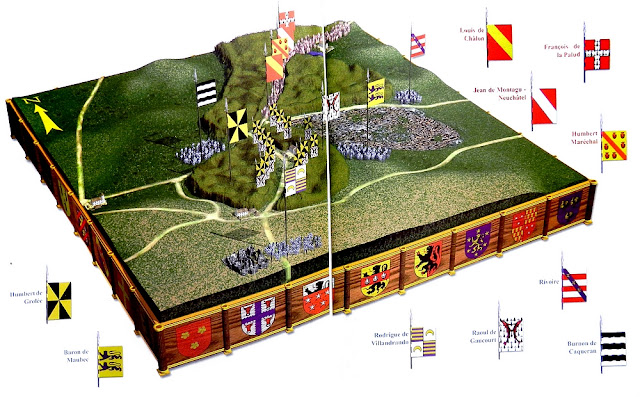LA BATAILLE
DE NANCY - 5 janvier 1477
Une
victoire fondatrice pour le duché de Lorraine
Dès l’accession au
duché de Lorraine de René II le 2 août 1473, Charles de Bourgogne
contesta cette
principauté, rêvant de l’incorporer à son
patrimoine. La bataille qui s’ensuivit,
régla
définitivement la question des
prétentions bourguignonnes.
"La bataille de Nancy, 5 janvier 1477"
Miniature du manuscrit "La Nancéide" de Pierre de Blarru. 1518.
(Musée Lorrain de Nancy)
A gauche, les Suisses et les Lorrains , René II en tête chargent les Bourguignons.
Au dessus, le duc de Bourgogne et son cheval sont morts.
Dans le coin inférieur droit, Campo Basso massacre les Bourguignons en fuite.
Dans le coin inférieur gauche, les forces alliées ont capturé les canons bourguignons
et les ont tournés vers l'ennemi. En plein champ, c'est la bataille qui fait rage.
Enfin, en haut, la ville de Nancy
Charles le Hardi
(l’appellation de Téméraire est tardive) obtint avec le traité
signé à Nancy le 15 octobre 1473 le
droit de placer des garnisons bourguignonnes dans plusieurs
forteresses lorraines lui permettant de relier toutes ses terres (la
Bourgogne, le Charolais, la vallée de la Flandre, le Brabant, le
Hainaut, l’Artois, la Picardie, le Luxembourg et le comté de
Thionville.
Mécontent, le duc de
Lorraine s’employa à harceler les
troupes de Charles par des embuscades.
Déterminé, Charles mit
le siège devant Nancy. Les bombardes bourguignonnes ébranlant petit
à petit les remparts, René II préféra ordonner le 25 novembre aux
2 200 Allemands et aux 500 Gascons présents à ses côtés de
quitter Nancy ; ils le feront le 27.
"Charles le Téméraire assiégeant Nancy, 22 octobre 1476"
Enluminure tirée de "La Chronique de Lucerne" (1511-1513)
écrite par le chroniqueur Diebold Schilling der Jüngere (1460-1515)
(Bibliothèque Centrale de Lucerne)
Nancy aux mains de
Charles, Jean de Rubempré, seigneur de Bièvre, devint
gouverneur de la Lorraine et chef de la garnison bourguignonne.
La révolte de René
II de Lorraine
Profitant du départ de
Charles de Bourgogne le 14 février 1476 pour la Suisse où il
voulait soumettre les « vachers » qui avaient pris
plusieurs de ses châteaux, René II assiégea et reprit la cité
ducale.
La nouvelle de cette
prise indisposa Charles qui marcha en direction de la Lorraine avec
10 à 12 000 hommes. A Pont-à-Mousson, le combat faillit s’engager
entre les deux factions mais René II préféra se retirer estimant
son infériorité numérique trop défavorable.
Le duc de Bourgogne, qui
avait accordé sa confiance au condottiere Napolitain Cola II de
Monteforte, comte Campo Basso, un traître vendu au roi de France et
au duc de Lorraine, fut abandonné par ce dernier.
Charles installa son
quartier général à la commanderie Saint-Jean et ordonna le siège
de Nancy dès le 22 octobre 1476. Entre temps, le duc de Lorraine
avait quitté subrepticement sa capitale pour aller chercher de
l’aide auprès des cantons suisses et des Alsaciens. La garnison
lorraine et les habitants de Nancy promirent de tenir aussi longtemps
que possible.
Gaston Save, La tente de Charles Le Téméraire à la Commanderie Saint Jean, 1896
© Musée lorrain, Nancy
Arrivé à Bâle, le 2
novembre 1476, René II parvint à convaincre les cantons suisses de
l’aider dans cette tâche ardue de recouvrer son duché. Il se
porta ensuite à Berne et à Lucerne où il leur promit une forte
somme. Le maître d’hôtel ducal, Suffren de Baschi fut alors
chargé de se rendre à Nancy pour prévenir la garnison et ses
habitants de la venue imminente du duc mais il fut capturé et pendu
par les Bourguignons (en représailles René II demanda l’exécution
d’une centaine de prisonniers).
Poursuivant sa campagne de
recrutement, le duc de Lorraine arriva en Alsace pour convaincre les
Alsaciens du bien fondé de sa requête. Guillaume Herter de
Strasbourg accepta volontiers de l’aider. Pendant ce temps là, les
Suisses se concentrèrent à Bâle avant de traverser l’Alsace où
ils se livrèrent à de vils pillages. Oswald de Thierstein régla la
somme de 2 500 florins, première solde promises aux combattants
suisses et alsaciens, afin de s’assurer du soutien réel des
Suisses.
L’assaut bourguignon du
26 décembre 1476 fut très coûteux en hommes, Charles perdit un
tiers de ses effectifs. Le froid et la neige causèrent également la
mort de 400 Bourguignons dans la nuit de Noël. Puis comme prévu, le
1er janvier, le comte de Campo Basso quitta le camp du duc Charles
avec sa condotta prétextant d’aller au devant des renforts venant
de Flandre ; en réalité, le duc de Lorraine lui avait garanti la
seigneurie de Commercy en échange de son aide.

"L'armée lorraine quittant Saint-Nicolas de Port"
Enluminure tirée de "La Chronique de Lucerne" (1511-1513)
écrite par le chroniqueur Diebold Schilling der Jüngere (1460-1515)
(Bibliothèque Centrale de Lucerne)
Le 3 janvier 1477, René
II passa à Croismare et le 4 arriva à Saint-Nicolas-de-Port, point
de ralliement des combattants, dans la matinée. Les Suisses, les
Allemands et les Alsaciens y parvinrent dans l’après-midi. Une
lanterne fut placée sur le clocher de la basilique Saint-Nicolas
pour signaler aux Nancéiens l’arrivée imminente de leur duc.
Les forces en
présence et le champ de bataille
Les sources
bourguignonnes d’Olivier de la Marche et de Jean de Margny
apportent de maigres renseignements. Par contre, du côté des
alliés, les informations sont plus loquaces avec notamment les
récits vivants des Lucernois Peterman Etterlin et Diebold Schilling
et de Pierre de Blarru, personnages ayant prit part à la bataille.
Enfin, la chronique de Lorraine, source à ne pas négliger, est
néanmoins à considérer avec prudence.
La composition des deux
armées était hétéroclite. En effet, René II avait réussit à
réunir près de 20 000 combattants (dans « La
vraye déclaration du fait et conduite de la bataille de Nancy »,
René II indiqua que son armée comprenait de 19 à 20 000 hommes)
venant de Suisse, d’Alsace et d’ailleurs ; Charles de Bourgogne
en rassembla entre 6 000 et 10 000 dont des Hollandais, Savoyards,
Anglais et mercenaires italiens.
Les coalisés
Les contingents de
cavaliers lorrains étaient sous le commandement de René II et de
son maréchal le comte Oswald 1er de Thierstein. Les Suisses, qui
composaient le noyau principal du duc de Lorraine avec 6 000
volontaires (piquiers, hallebardiers et couleuvriniers), venaient de
Zurich (2 430 hommes), de Lucerne (1 200 hommes), de Berne (1 087
hommes) et d’autres ortes (Schaffouse, Soleure, Appenzell,
Fribourg, Unterwald et Uri). Le lucernois Henrich Hassfurter, le
zurichois Hans Waldmann et le bernois Brandolfe de Stein en étaient
les principaux capitaines.

Combattants lorrains. Reconstitution de la Compagnie Médiévale
"La Massenie de Saint-Michel" de Saint-Mihiel. Blâmont 7 juillet 2003.
Les Alsaciens (de Colmar et de
Strasbourg), sous les ordres du strasbourgeois Guillaume Herter de
Hertenegg et les Bâlois fournirent chacun un contingent
d’infanterie. L’abbé de Saint-Gall, le comte Eberhard VI de
Wurtemberg et les cités de Schaffhouse et de Rothweil envoyèrent
des cavaliers. Au dessus de cette armée, flottaient les bannières
et pennons des évêques de Bâle et de Strasbourg ainsi que du duc
d’Autriche, Sigismond.
 Combattants Suisses, couleuvriniers, piquiers et hallebardiers".
Pierre de Blarru. La Nancéide
Combattants Suisses, couleuvriniers, piquiers et hallebardiers".
Pierre de Blarru. La Nancéide
Gravure sur bois. 151. Imprimé à Saint-Nicolas-de-Port par Jean Jacobi
(Bibliothèque diocésaine de Nancy)
René II connaissait bien
les Suisses et les Strasbourgeois pour avoir combattu à leurs côtés
à Morat avec 250 cavaliers. Il fut même adoubé à
cette occasion par Guillaume Herter de Hertenegg dans la clairière
de Lurtingen le 22 juin à l’âge de 20 ans.
Le condottiere napolitain
Cola II de Monteforte, accompagné de ses fils, de son frère Angelo
et de son cousin Jean apporta son aide à René II en le rejoignant
avec 300 cavaliers.
Les Bourguignons
L’armée du duc de
Bourgogne offrait une bien piètre image depuis les cinglantes
défaites de Grandson et de Morat en mars et juin 1476. Il paraissait
donc normal que Charles de Bourgogne ne put constituer
une armée à la hauteur de ses ambitions. Nous savons que le
8 décembre 1476, environ 10 000 hommes furent payés pour leur
service par le prince mais les conditions météorologiques et les
conflits larvés entamèrent ce potentiel militaire. A ses côtés se
trouvaient entre autres son frère le Grand-Bâtard Antoine, Philippe
de Croy comte de Chimay, Engelberg II comte de Nassau-Dillenburg,
Frédéric de Florsheim comte de Bade, Philippe de Hochberg comte de
Neufchâtel et Olivier de la Marche.
Deux corps de cavalerie
étaient commandés par Josse de Lalaing et le condottiere napolitain
Jacques de Galeotto. Charles avait prévu des pièces d’artillerie.
Des archers anglais montés, des contingents savoyards et hollandais
complétaient le dispositif.
Une bataille perdue
d’avance
Ce 5 janvier 1477, il
neigeait. Après la lecture de la Cyropédie, Charles de Bourgogne
rassembla ses troupes tôt dans la matinée. Il enfourcha son cheval
noir dénommé Moreau et selon les récits de l’époque, lorsque
son écuyer lui tendit son casque, le cimier au lion d’or le
surmontant s’en détacha et tomba à terre ; le duc désabusé
aurait prononcé "Hoc est signum Dei "(c’est un présage
de Dieu).
Il redoubla alors d’ardeur, se plaça au centre avec son
artillerie (à l’emplacement exact de l’actuelle église
Notre-Dame-de-Bonsecours) devant lui sur la route venant de Jarville,
les archers anglais derrière, et demanda à Josse de Lalaing et ses
cavaliers de prendre position sur sa droite et à Jacques Galeotto de
s’installer avec ses hommes sur sa gauche. La Meurthe protégeait
le flanc gauche et le bois de Saurupt le flanc droit.

Vous pouvez agrandir cette vignette en cliquant dessus !
En face, les coalisés
venaient de Saint-Nicolas-de-Port, qu’ils avaient quitté à huit
heures du matin. Ils s’arrêtèrent un peu avant le village de
Jarville afin de déterminer le plan de bataille. Deux déserteurs
Bourguignons capturés révélèrent à René II et à ses alliés la
disposition des troupes du Téméraire ainsi que la configuration du
terrain. Pendant toute la délibération, la neige tombait à gros
flocons. Prendre le flanc droit tenu par la cavalerie de Lalaing
était la clef de cette bataille.
Vous pouvez agrandir cette vignette en cliquant dessus !
L’ordre de marche fut alors
décidé. René II remonta sur sa jument grise La Dame puis se plaça
en tête de l’armée avec ses cavaliers lorrains. Le comte de Campo
Basso fut envoyé à Bouxières-aux-Dames pour garder le pont et
empêcher la fuite des Bourguignons par la route principale menant à
Metz.
Vous pouvez agrandir cette vignette en cliquant dessus !
L’avant-garde (3 ou 400
cavaliers lorrains et français) commandée par le seigneur de
Rosières-aux-Salines, Vautrin Wisse, emprunta alors le petit sentier
contournant le bois de Saurupt, traversa le ruisseau de Heillecourt,
passa à proximité de la ferme de la Malgrange, franchit le ruisseau
de Jarville, coupa la route menant à Vandoeuvre, effaça le ruisseau
de la Madeleine, progressa sous le couvert du bois de Saurupt et
s’arrêta à la lisière de ce dernier à un kilomètre des
positions bourguignonnes.
Les piquiers, hallebardiers et
couleuvriniers suisses ; René II et ses lieutenants Oswald de
Thierstein en tête lui avaient emboîté le pas. Les combattants
étaient éreintés après cette manoeuvre de contournement par ce
froid glacial et cette neige abondante. En ce début d’après-midi,
Charles de Bourgogne ne se doutait pas de la présence d’une telle
force (400 cavaliers, 4000 couleuvriniers, 4000 piquiers, 3000
hallebardiers et 2000 hommes d’armes) sur son flanc droit, force
prête à bondir.

Le duc René II au cœur de la bataille, à cheval et paré de la croix de Jérusalem
(dessin de Pierre Joubert)
A 13 heures, la neige
cessa de tomber et le soleil apparut;
l’ordre d’attaquer fut alors donné. Les Suisses firent alors
souffler trois longs et lugubres coups
de trompe (cantons d’Uri et d’Unterwald !), signal de
l’assaut. La surprise fut totale, les cavaliers de Josse de Lalaing
submergés, reculèrent.
L’artillerie de Charles impuissante, ne
put refouler ce flux de combattants suisses, lorrains, alsaciens et
allemands. Les couleuvriniers suisses avancèrent en déchargeant
toutes leurs munitions, suivis
des hallebardiers et des piquiers qui embrochèrent les Bourguignons
encore vivants.
L’armée restée en
face du Téméraire passa aussi à l’attaque. L’artillerie
capturée fut retournée contre les Bourguignons. Les archers anglais
infligèrent des pertes aux alliés mais rapidement, ils cédèrent
face à cette marée humaine. Jacques de
Galeotto, estropié, se retira en traversant au gué de Tomblaine
puis s’enfuit vers le Nord.
La bataille de Nancy - Charles le Téméraire en plein combat
Enluminure tirée de "La Chronique de Lucerne" (1511-1513)
écrite par le chroniqueur Diebold Schilling der Jüngere (1460-1515)
(Bibliothèque Centrale de Lucerne)
Le duc de Bourgogne et
ses hommes assaillis de toute part se replièrent vers la commanderie
Saint-Jean et vers Bouxières-aux-Dames. Rattrapés par les Suisses
et les Lorrains, ils furent achevés près de l’étang Saint-Jean.
Charles, blessé, s’écroula. Claude de Bauzemont, châtelain de
Saint-Dié, acheva le Grand Duc d’un coup de hache sur la tête.
René II et ses
alliés font une entrée triomphale à Nancy.
En fin de journée, René
II demanda au condottiere s’il n’avait pas vu le duc de Bourgogne
; la réponse fut négative. Le duc de Lorraine fit quand même son
entrée dans sa chère capitale. Mais, son esprit était accaparé
par Charles, où était-il, avait-il fui
ou était-il mort ?
Au cours du combat, Jean
Max von Eckwersheim captura le comte de Nassau, Jean de Bidos,
seigneur de Pont-Saint-Vincent, Antoine
le Grand Bâtard et Guillaume de Rappolstein le comte de Chimay.
D’après un chroniqueur suisse, 5 699 cadavres de Bourguignons
gisaient dans la plaine nancéienne ; chiffre incluant
vraisemblablement les combattants morts lors des sièges de Nancy. La
petite armée de Charles perdit en tout cas les 2/3 de ses effectifs
si l’on se réfère au nombre de compagnies d’archers anglais
rentrés dans leur patrie en janvier et février 1477. Cette défaite
fut cuisante et coûteuse en hommes.

Dague et éperon à ailette (XVe siècle) trouvés près de l'étang Saint-Jean
(Conservés au Musée Lorrain de Nancy)
Les honneurs rendus
au Téméraire
Le lundi 6 janvier 1477,
René II obnubilé par le Téméraire partit à sa recherche,
interrogea des prisonniers, envoya des hommes arpenter la Lorraine et
même au-delà. La prospection demeurait infructueuse quand le soir
venu le Napolitain Cola de Montforte lui amena un jeune page romain,
Baptiste Colonna. Celui-ci lui annonça qu’il était au service du
prince tant recherché et qu’il l’avait vu s’effondrer à
proximité de l’étang Saint-Jean.
Le lendemain, mardi 7, le
page mena le duc de Lorraine dans le pré de Virelay non loin de
l’étang Saint-Jean où il lui présenta son maître, étendu parmi
d’autres cadavres. Il était nu, dépouillé de ses atours, la tête
prise dans la glace, une joue dévorée par un loup et le corps
piétiné par des chevaux.
Le médecin portugais du
Grand Duc, Lopo da Guarda fut mandé. Il fit une inspection
rigoureuse de son prince, releva qu’il avait le crâne fendu par
une hache, deux plaies profondes dans le bas des reins et les cuisses
dues à des coups de piques ; puis le reconnut
grâce à six signes : des dents manquaient à sa mâchoire, une
cicatrice au cou (résultat d’un coup de lance à la bataille de
Montlhéry), la trace d’un furoncle à l’épaule, des ongles très
courts, un gros orteil au pied gauche, un ongle incarné et la trace
d’une fistule au testicule droit.
Formellement identifié,
la dépouille de Charles fut portée dans une maison de Nancy, chez
Georges Marquiez ; son corps fut lavé puis revêtu d’une longue
robe brodée et la tête couverte d’une toque rouge.

Le duc de Lorraine, René II devant la dépouille
du duc de Bourgogne, Charles le Téméraire, le 12 janvier 1477.
Chronique de Louis XI, dite Chronique scandaleuse (1498-1502, par Jean de Roye)
Le samedi 11
janvier, l’embaumement du corps eut lieu et le lendemain, René II
fit célébrer une messe à 6 heures du matin en la collégiale
Saint-Georges. Enfin, le corps du Téméraire et celui de Jean de
Rubempré furent inhumés dans le transept.
Pour commémorer son
succès, René II édifia un sanctuaire appelé Notre-Dame de la
Victoire ou de Bonsecours dès 1484 sur le terrain même où se
déroula le combat ; Olry de Blâmont, évêque de Toul la consacra
en 1498. La cité de Saint-Nicolas-de-Port se dota également d’une
magnifique basilique dès 1480, signe de la dévotion de René II qui
participa financièrement à son édification.
*
Comme le souligna Pierre
de Ram au XIXe siècle dans son Histoire des chroniques liégeoises
au temps de Charles le Téméraire : « le duc perdit son trésor
à Grandson, son honneur à Morat et la vie à Nancy ». A Nancy,
comme à Héricourt et Morat, la bataille se déroula suivant trois
axes : surprise, panique et massacre. La supériorité numérique des
coalisés eut raison des Bourguignons.
La puissance
bourguignonne s’éteignit
après plus d’un siècle d’histoire orgueilleuse le
5 janvier 1477 à Nancy. Le Grand Duc mort, le rattachement de son
duché à la couronne de France, théoriquement effectué le 31
janvier 1477, a en fait demandé une conquête marquée notamment par
les soulèvements populaires de Dijon (1477), de Beaune et de
l’Auxois (1478).
Olivier PETIT
Historien médiéviste
Créateur et
administrateur des blogs
____________________________
Sources
historiques:
Pierre de BLARRU, La
Nancéide ou la Guerre de Nancy, traduction de F. Schütz, 1840.
Pierre de BLARRU, La
Nancéide, poème consacré à la victoire remportée devant Nancy
par le duc de Lorraine René II sur le duc de Bourgogne, Charles le
Téméraire, le 5 janvier 1477, traduction de Jean Boës -
(Collection "Etudes anciennes 32") - Editions De Boccard -
2006
Différentes chroniques
Bibliographie sélective
:
La bataille de Nancy,
catalogue de l’exposition 1477-1977, Musée Historique Lorrain.
Cinq centième centenaire
de la bataille de Nancy 1477, Actes du colloque, 1977, Université
Nancy II.
P. FREDERIX, La mort de
Charles le Téméraire, Gallimard, 1971.
C. PFISTER, Histoire de
Nancy, Paris 1902-1909.
Pour ceux qui veulent avoir une version "papier" de mon article, vous pouvez acheter
le dernier numéro d'Histoire Antique et Médiévale (Janvier-Février 2017)
____________________
Copyright - Olivier PETIT - La France Médiévale - 2017 © Tous droits réservés