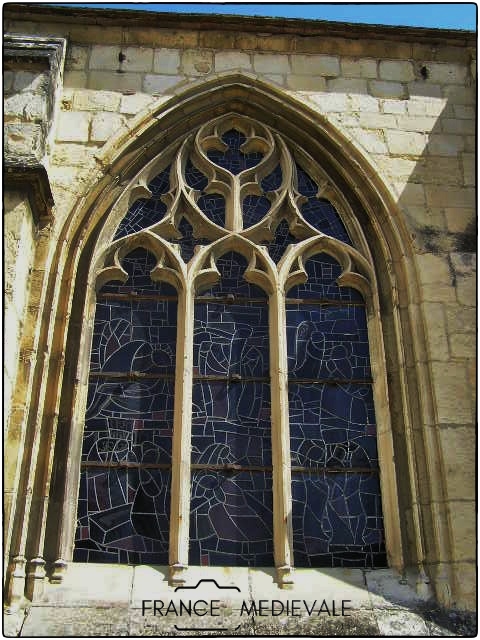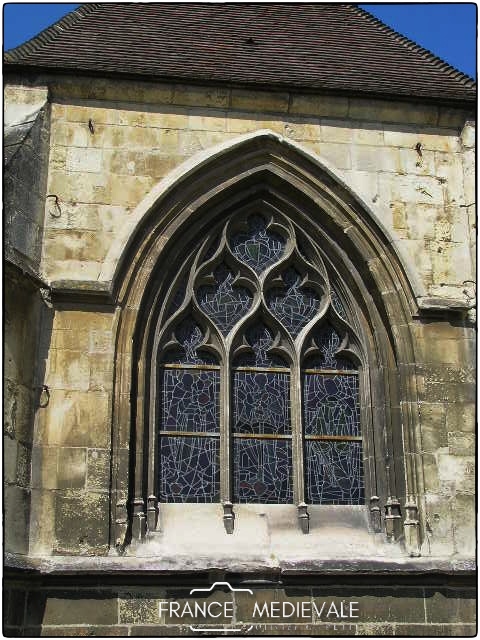Le village de Colombier-Saugnieu a gardé de son passé médiéval, les restes d’un château
de pierre édifié par les seigneurs de Colombier, qui au XIIIe siècle abandonnèrent,
en partie, leur motte castrale (situé à mi-chemin entre le village de Colombier-Saugnieu
et le hameau de Montcul)
Le site du castrum de Colombier-Saugnieu s’est développé à partir du XIIIe siècle avec la
construction du bourg fortifié et donc l’encadrement de la population venant du site
de la motte castrale de Colombier.
De l’ancienne forteresse (ou castrum) élevée par les seigneur de la Tour, il subsiste le bourg
fortifié avec sa porte et ses remparts ainsi qu’une tour circulaire, le donjon.
fortifié avec sa porte et ses remparts ainsi qu’une tour circulaire, le donjon.
Porte en ogive
La porte fortifiée
représente l’entrée principale du bourg et est distante du donjon de
90 m environ.
Quand aux remparts, ils encadrent ladite porte et sont conservés en partie près
de la tour féodale.
Les remparts ne sont conservés au sud, sur une distance de 20 m et à l’ouest, sur 5 m.
Cette porte, ouverte en ogive, disposait au Moyen Age d’un herse dont on peut voir
les gaines dans lesquelles elle glissait. Un assommoir accueillait les assaillants.
Son parement est fait de pierres à bossage, qui étaient censées empêcher les béliers
de détruire la muraille et un moyen d’enjoliver un parement.
La porte fortifié se trouve, elle aussi au sud, et représente le seul passage entre les remparts.
On accédait à la tour circulaire à travers le village en passant devant l’église paroissiale.
Cette tour est encore planté sur sa motte. Colombier conserve une tour disposant d’une
enceinte polygonale arasée, à l’intérieur même du village fortifié.
Partie basse du donjon visible à l'intérieur de la maison
Le donjon est aujourd’hui enchâssée dans un bâtiment d’habitation contemporain.
Extérieurement, l’appareillage est fait avec des pierres de tailles bien agencées ;
quand on pénètre à l'intérieur de la maison, on retrouve la base de la tour talutée
avec une meurtrière en forme d’étrier.
En pénétrant à l’intérieur même de cette tour, nous remarquons trois niveaux :
un rez-de-chaussée,
un premier étage et la plate-forme sommitale.
Le
premier étage a conservé des fenêtres à coussièges. Pour accéder au
toit, autrefois
crénelé, un escalier fut aménagé dans le mur de la
tour.
Escalier aménagé dans l'épaisseur des murs
Voûtement en brique du rez-de-chaussée du donjon
Ci-dessous de nouvelles photos prises en 2024
Copyright - Olivier PETIT - La France Médiévale - 2016-2024 © Tous droits réservés